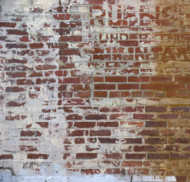Pédagogie & Structures d'enseignement artistiqueTerritoriales
Arthur Thomassin
Dir. CMM Cergy
Compositeur
Doct. E.H.E.S.S.
Anc. Dir. Du programme
« l’Europe de l’Ecriture et de l’Image »
CNRS-Min. Culture - Educ. Nat.
Extraits de la conférence
l’Education Mutualisation de l’enseignement général et artistique
…….Je vous propose d’aborder ces quelques propositions sur l’ensemble du sujet à travers la complémentarité entre Prométhée et Epiméthée ouvrant « la boîte de Pandore », et de proposer plutôt une issue constructive à l’encontre des allégories du passé.
……Toutefois les chiffres qui suivront sont assez significatifs de la sollicitation du denier public pour des résultats souvent coûteux et insuffisants dans un « engrenage » sans fin puisqu’on ignore souvent localement et volontairement la mutualisation des dynamiques locales et des finances en matière d’éducation.
Chaque ministère reste « figé » sur ses positions institutionnelles en abordant les avis des différentes commissions selon ses propres intérêts.
A cela nous ajouterons la lourdeur et la complexité des relations partenariales à cause des organigrammes qui sont spécifiques à chacune des institutions et qui ralentissent – pour ne pas dire rendent inopérantes ou empêchent la communication directe avec les protagonistes concernés – l’application des textes concernant l’éducation artistique et plus précisément de la pédagogie musicale.
Education Nationale
Primaires : inspections sectorielles
Secondaire collèges: inspection académique du 2d degré
Lycées : inspection régionale
Diplômes reconnus : CAPES, Agrégation, DUMI animation artistique
Ministère de la Culture et CNFPT – Etablissements d’Enseignement Artistiques Territoriaux.
Tutelles : Mairies, Agglomérations, etc.
Diplômes reconnus : Diplôme d’Etat et Certificat d’Aptitude, DUMI équivalence D.E.
Diplôme nécessitant le concours CNFPT afin de permettre la titularisation.
Programmes de l’Education nationale, qui souvent se résument par l’abstraction de tout lien entre les matières enseignées dans l’établissement et la musique.
Les services communaux et départementaux desquels dépendent les directeurs des établissements d’enseignement artistique, s’organisent quasi totalement selon l’organigramme suivant :
Maire
Adjoint Elus à la culture (non administratif) – Adjoint Elus de l’Education
Administratifs : DGS/DGA
Directeur de l’Action Culturelle Directeur de l’Education Scolaire (très rarement un Chef de Service Spectacle Vivant) chef de Service
Directeur de l’Etablissement d’ens. Art. Service des relations avec les Ecoles
Primaires, et Service des relations avec le secondaire.
Selon l’Institution (Mairie, Agglomération, Département, Région) un service dédié aux Lycées et aux partenariats avec l’Université (selon le territoire).
Les programmes en matière musicale sont spécifiques au CRR, CRD, CRC, Ecoles municipales et ou Associatives non agréées mais fonctionnant selon le Schéma directeur du Ministère de la Culture.
Quelques Propositions (rappel mentionant que les Statuts des Assistants Spécialisés de 1ère et 2ème Classe et Professeurs d’Enseignement Artistiques bénéficient de ceux des enseignant de l’Enseignement scolaire (périodes d’enseignement et des vacances scolaires):
-
Fonder un corps commun pour la formation des musiciens pédagogues avec des diplômes nationaux communs aux trois ministères.
-
Le transfert des compétences entre les différentes inspections des trois ministères (E.N., Culture, CNFPT) afin de former des enseignants spécialisés – dans l’état actuel des choses – intégrer les enseignants sur le terrain après une évaluation répondant aux critères des cursus diplômant en y ajoutant le REP et la VAE (gratuite !) afin d’absorber les professionnels musiciens vacataires et qui dispensent des cours dans certaines communes.
-
Rendre obligatoire la formation des enseignants des Ecoles Maternelles et Primaires, dans le domaines des Arts et surtout en développant l’enseignement artistique dans sa transversalité avec les matières scolaires : histoire, géographie, littérature, mathématique et géométrie, langages et cultures.
-
Mettre en place un Programme Initial retraçant les points principaux de la pédagogie des différentes spécialités artistiques et selon la transversalité entre les arts sonores, graphiques, théâtre, danse, photo, cinématographie, etc…
-
Unifier les points principaux des programmes d’enseignement artistique amateurs (socle commun) entre les deux corps d’enseignants (E.N. et Etab. d’Ens. Art. ).
Cela implique que dans le cadre de verticalisation institutionnelle de la « pyramide » constituée administrativement entre les Ecoles Maternelles, Primaires, Collèges, Lycées, la consolidation de la filière de la formation et les pratiques amateurs des arts, doit être au bénéfice de l’allègement des charges financières et de leur regroupement ciblé vers la formation spécialisée des CRD et CRR – formation permettant le partenariat ouvert avec les universités et les CEFEDEM.
Dans ce sens, l’allègement des classes dites CHAM (classes à horaires aménagés) et la généralisation des mesures proposées permet d’équilibrer les dépenses au prorata du nombre d’élèves (très réduit comparativement avec le nombre des élèves amateurs), souhaitant véritablement suivre la filière spécialisée (voir environ 5% sur l’effectif des CHAM et souvent ceux qui viennent de la filière littéraire).
Quelques Propositions administratives et fonctionnelles des Institutions
-
Mise en place d’un Statut administratif unique – harmonisé - concernant les compétences d’enseignement entre le CAPES et le D.E. artistique (musique, arts plastiques etc…) portant sur la formation et la qualification des enseignants dans le Primaire et les Secondaire (collèges).
-
Mise en place d’un Statut administratif unique concernant les compétences d’enseignement entre l’Agrégation et le P.E.A. artistique (musique, arts plastiques etc…) portant sur la formation et la qualification des enseignants des Collèges et Lycées.
-
Définition d’une qualification des C.A. menant aux postes de P.E.A. ayant l’homologation universitaire et permettant d’enseigner les spécialités théoriques et techniques au grade de M.C. associé en université. Cela permet d’unifier les filières de formation avec la spécialisation « histoire et techniques des Arts » en décloisonnant du point de vue administratif la mobilité entre Conservatoires nationaux et régionaux et les U.V. universitaires. Egalement, cela justifierait la qualification doctorale et les Masters obtenus dans les spécialités artistiques et les qualifications obtenues à travers un cursus essentiellement universitaire.
Au niveau territorial
-
La mise en place de Commissions régionales et départementales représentatives des communes, ayant compétences, rôle décisionnaire et pouvoir d’application régionale (ou du moins départementale), tronc commun de direction pédagogique et administrative, pouvant nommer les enseignants spécialisés dans les domaines artistiques, selon « l’architecture » structurelle des Etablissements de formation artistiques amateurs et spécialisés sur un territoire donné.
-
Répartitions des A.E.A. et P.E.A. actuels selon leurs qualifications, sur l’ensemble des secteurs d’enseignement scolaires et artistiques dans les établissements figurants au niveau départemental. Cela implique une mise à plat, département par département de la répartition selon la nécessité réelle en rapport avec l’application des textes ministériels et l’harmonisation des programmes d’enseignement. Cela permet également de clarifier la volonté d’absorber la précarité des « temps d’enseignement morcelés » entre les établissements et de fidéliser de manière constructive l’engagement des enseignants à travers des « temps pleins » avec des statuts communs entre l’Education nationale et le CNFPT-Culture.
A mon sens, ces quelques propositions qui engageraient une refonte complexe de l’enseignement artistique et des liens pédagogiques préexistants entre les institutions républicaines entraînant la transversalité pyramidale entre les matières scolaires et les formations menant aux pratiques amateurs puis, au choix des élèves, à une filière spécialisée avec ses diversifications en fin de parcours de formation, clarifieraient également l’engagement budgétaire de l’Etat et la répartition budgétaire territoriale d’autre part.
Partant du principe de l’induction évidente à la socialisation et à la pluriculturalité sous la forme des connaissances dispensées et dépourvues d’études comparatives, ainsi que la sensibilisation des jeunes et mêmes des adultes à travers la découverte de la transversalité entre les matières étudiées et les arts, suscite plusieurs autres points fondamentaux de la formation artistique en milieu scolaire et périscolaire. Cela touche directement la finalité sociale de l’engagement à venir des élèves, de la valorisation du contexte parental, comme du corps professoral.
Dans ce sens il me paraît indispensable d’informer, de former et de donner des choix d’avenir aux jeunes élèves, dès le niveau de 3ème scolaire en collaboration directe avec les établissements d’enseignement artistique municipaux comme régionaux, ouvrant sur les métiers artistiques ; plus précisément dans le domaine musical : technicien son – plateau –salle, lutherie, régie lumières, etc….
Il faut savoir que souvent les établissements enseignant ses disciplines sont saturés de demandes, qu'il n'existe que très peu de centres nationaux (hors filière privée) qui préparent à ces filières dans le monde du travail, et que de nombreuses opportunités de travail existent (mêmes ponctuelles) dans les communes organisatrices de spectacle vivant, ou ayant des institutions d’enseignement artistique avec des programmes de diffusion. Comme susmentionné, en l’état actuel, ces domaines sont souvent laissés aux établissements privés, ce qui ne facilite en rien la démocratisation et l’accession des jeunes.
Un très bref regard actuel sur le terrain
…..Dans l’état actuel des choses, la répartition budgétaire des subventions attribuées par l’Etat via les Conseils Régionaux et Généraux, apparait systématiquement insuffisante proportionnellement aux nombres de postes comptabilisés et dans leur finalité dédiée sur le terrain ; pourtant le domaine concerné par ces attributions vise par regroupement des domaines de l’éducation et de l’enseignement.
A titre d’exemple l’Etat verse aux Collectivités territoriales plusieurs milliards (environ 60 Md en 2009) pour l’ensemble des domaines en charge des communes.
Cela concerne environ 36 683 communes (en 2011) et environ 2600 intercommunalités en janvier 2012.
Dans le domaine de l’Enseignement Artistique Spécialisé (comprenant musique, danse, théâtre essentiellement), la France compte environ 2640 établissements spécialisés tout niveaux confondus et un tissus associatifs dédié à l’enseignement artistiques et dont le nombre n’est pas répertorié, mais pour avoir une idée, prenons l’exemple d’une commune qui compte une Ecole Municipale de Musique et une trentaine d’associations artistiques qu’elle subventionne à hauteur d’environ 0,5% du budget global dédié à la Culture:
Autrement, dans le domaine de la formation et la structure musicale en France, fonctionnent plusieurs types de structures :
2 Conservatoires Nationaux Paris et Lyon – financement direct par l’Etat et les Régions.
36 Conservatoires à Rayonnement Régional (ex CNR) : Financement partagé entre le budget des Agglomérations, EPCC et EPCI ayant une compétence culturelle avec une moyenne entre 3% et 12% du budget global de fonctionnement, auquel s’ajoutent les Subventions des Conseils Régionaux (DRAC) et Conseils Généraux.
101 Conservatoires à Rayonnement Départemental (ex ENM) : Financement partagé entre le budget des Agglomérations, EPCC et EPCI ayant ou non une compétence culturelle avec une moyenne entre 5% et 25% du budget global de fonctionnement, auquel s’ajoutent les Subventions des Conseils Généraux.
Au total environ 137 000 élèves et environ et 8500 enseignants.
113 Ecoles de Danse 19 000 élèves et 638 enseignants
75 écoles de Théâtre 3300 élèves et 136 enseignants.
Le nombre des élèves de l’Education nationale en lien direct avec ces établissements spécialisés est de 1 100 000 environ (selon le dispositif défini au niveau académique).
Au niveau Communal nous pouvons compter sur environ 2500 écoles de musique municipales dont la fréquentation moyenne en période périscolaire est d’environ 700 élèves.
Ces Conservatoires Agréées ne délivrent aucun Diplôme reconnu du point de vue national. Leur principale mission est dans le meilleur des cas la préparation des élèves pour une orientation vers des CRR ou CRD, ou alors d’une manière générale, contribuer à la sensibilisation de tous les publics, la formation amateur et faire vivre les arts dits « du théâtre et de la rue »….
Le nombre d’élèves des écoles municipales d’enseignement artistique est globalement d’environ 1 500 000 en période périscolaire auxquels s’ajoutent les quelques 137 000 élèves des Conservatoires spécialisés.
Le nombre d’Ecoles Primaires de l’Education Nationale en France (en 2010) est de 53 800.
En 2009, presque 7 millions d’enfants étaient scolarisés dans le Primaire, 5 millions dans les collèges et 1,4 millions de lycéens.
Le total approximatif d’élèves scolarisés est de 13,4 millions dont env. 1 350 000 enseignants. La surcharge des classes est une réalité douloureuse car ces chiffres ne tiennent pas compte de la répartition géographique, ni du rapport entre l’Ecole publique et l’Ecole Privée qui scolarise environ 2 300 000 élèves. La subvention de l’Etat en 2008 était d’environ 12,5 milliards auxquels s’ajoutent les subventions des collectivités territoriales (1 élève= env. 5000€ dans le privé pour env. 2800€ environ dans le public).
En comparant ces chiffres avec ceux de l’Education artistique le rapport des élèves bénéficiant de l’enseignement artistique serait d’environ 17% (hors milieux associatifs) – et non pas le pourcentage annoncé par le Rapport Lockwood.
Par ailleurs, le rapport Lockwood dont un des points positifs est celui de la création des EDAM, EDAD et EDAT (et pourquoi pas des EDAMDTC – Ecole des Arts de la Musique, Danse, Théâtre et Cinéma qui remplaceraient les CRR et CRD, déprécie à la fois et pousse les élus vers la suppression progressive des écoles municipales de musique à travers le désengagement financier des communes pour des structures républicaines et le transfert sous forme de « subventions » aux milieu associatif (très souvent sans la création de marchés publiques ou délégations de service publique).
C’est en quelques sorte « déshabiller Paul pour habiller Pierre » momentanément et au gré des finances et rythmes électoraux. C’est en cela que l’édification institutionnelle et territoriale de l’éducation artistique englobant de l’enseignement (et non pas uniquement de l’animation socio-culturelle), devient un enjeu du « ciment » républicain de notre Histoire.
Paradoxalement, la création de ces Ecoles des Arts repose pleinement sur l’harmonisation pyramidale entre des écoles municipales existantes – qui représentent déjà des centres de ressources de l’enseignement et des pratiques artistiques communales ou associatives locales – et le CRR ou CRD départemental, à travers la consolidation du socle et de l’aménagement du présent projet de la transversalité impliquant les établissements scolaires au niveaux des programmes et de la formation des professeurs.
TOUS les rapports des commissions nationales précisent que la pratique régulière d’un enseignement artistique amateur associé à l’enseignement général permet de résoudre les problèmes liés à l’insertion scolaire ou de la remise à niveau des élèves concernés.
Depuis la longue marche vers la régionalisation et le re-aménagement des pouvoirs législatifs de l’Etat dans le cadre de la décentralisation, on constate que les subventions accordées à la territoriale ciblent essentiellement les organisations territoriales ayant une compétence culturelle.
Le problème est qu’environ 80% de ces organisations territoriales et autres structures associatives entre les Communes, n’ont pas encore opté pour cette compétence pour des raisons de priorité locale et d’autonomie structurelle et budgétaire. Aucune loi ou décret, ne concerne une quelconque obligation envers les communes, mais également les CRR et les CRD, afin de mutualiser les financements et de rendre pyramidale la structure de l’enseignement artistique avec les établissements de l’éducation nationale. Toutes les conventions demeurent aux gré des collectivités territoriales. Pire encore, certaines grandes communes se retire de C.G.I. et sous le prétexte « d’économiser » sur la gestion, elles se désengagent de certaines prérogatives et obligations nationales, concernant les contrôles de la gestion, des statuts et cadres d’emplois, ou des répartitions budgétaires.
Aux investissements et aux différents budgets de fonctionnement (hors salaires du personnel d’Etat), il s’ajoute TOUTES les activités périscolaires de l’Educatif culturel (écoles de musique, centres culturels, Antennes de quartiers, etc….), de l’animation scolaire et des Centres des Loisirs, nouvelle appellation des « garderies » éducatives…dont le personnel est communal.
Par exemple dans une ville de 24 000 habitants avec un budget annuel global de 10 millions d’euros, la répartition vers l’animation socioculturelle comprenant la formation des jeunes à l’emploi, l’éducation citoyenne, la lutte contre la délinquance, la médiation culturelle associative, etc…, représente 58% du budget, au-delà de l’investissement en urbanisation (28%) et très largement au-dessus de l’investissement dans les structures de formation artistiques spécialisées qui est de 5% inclus dans l’animation socioculturelle. Ces répartitions sont en dessous de la moyenne nationale qui est d’environ 8%.
Le problème principal est que les subventions accordées par la Région ne cheminent pas vers ces manifestations et les villes - qui financent par ailleurs leurs propres structures (Bibliothèques, théâtres associatifs, Ecoles de Musique et d’Art, etc…) ainsi que des organismes artistiques privés -, et ne puisent que rarement dans les ressources locales pour constituer la cohérence à long terme des investissements concernant les pratiques pédagogiques de l’éducation et de l’enseignement.
Plus fréquemment, étant donné la situation économique, les Conseils Généraux ne proposent qu’une assez faible participation financière à la pérennité pédagogique des programmes dans leurs cohésions. Ces aides qui s’avèrent toutefois importantes pour les Villes, demeure essentiellement ciblée sur les actions culturelles locales et ponctuelles.
A cela s’ajoute le fait que les Villes comportent des services dédiés à la prestation événementielle des spectacles – notamment des festivals -, dont les budgets sont plus conséquents que ceux octroyés à l’enseignement ou à l’investissement structurel concernant l’application des directives portant sur les aspects intrinsèques de la pédagogie entre les matières scolaires de l’enseignement générale et les arts. Souvent les services culturels communaux, se substituent aux agents artistiques privés…et parfois heureusement, car ils permettent de rendre remarquable des artistes inconnus, allant à l’encontre des « modes » lancés par les médias.
Mais le plus souvent, ces mêmes services puisent dans les « spectacles phares » en achetant des représentations auprès de « célébrités » qui n’ont aucun lien avec la politique éducative et de l’enseignement, puisque la finalité recherchée demeure l’évènementiel dédié à la fréquentation du public – sorte de « audimat » communal. Il serait judicieux que ces programmations tiennent compte d’une « ligne » conductrice, permettant l’architecture de la dynamique culturelle des institutions éducatives d’une ville.
En ce qui concerne le développement de la sensibilisation aux métiers, celle-ci s’effectue dans une « tension » permanente avec les réalités des marchés de l’emploi. Cette situation complexe et délicate n’encourage que peu chez l’individu dans la société, les vocations matérialisées par les formations professionnelles des jeunes. Par ailleurs, cette philosophie de l’utile » qui différentie et classe les métiers selon la « demande économique au gré des marchés du travail, engendre l’instabilité psychologique des motivations à long terme et l’édification historique de la modernité à partir des « traditions » spécifiques des métiers.
Cela serait sans gravité si du point de vue générationnel et à moyen terme, les valeurs fondamentales de la République ne seraient pas dénudées de la notion d’homogénéité de la représentation du travail, en induisant le « nomadisme et l’indécision » à tous les degrés de l’enseignement général dont l’art identifie à la fois la Culture et son développement. Par ailleurs, cette stratégie issue des théories économiques, mène a la généralisation d’un enseignement « à la carte » et du point de vue territorial encourage une diversification superficielle des savoirs. A ce sujet, nous avons la conscience d’un passé historique où les réglementations locales développaient les identités culturelles plus que la valorisation des connaissances culturelles induites à l’éducation nationale, finissant par se prévaloir sur la raison d’Etat.
A cela, ajoutons le paradoxe de ce phénomène qui sous prétexte de l’originalité locale engendrée par les choix éducatifs, finissent dans l’incohérence du fonctionnement institutionnel. Nous remarquons ainsi que malgré tous les avis des Commissions, (l’Europe, Sénat, Assemblée nationale, Audits de la Fonction Publique Territoriale etc…), le suivi (lorsqu’il y a un prolongement sur le terrain, ce qui n’est que rarement le cas) est effectué ministère par ministère, sans aucune mutualisation budgétaire, ni modification du fonctionnement de l’éducation et a posteriori des programmes d’enseignement.
Plus précisément un décret de l’Education nationale concernant par exemple l’étude de la musique au quotidien dans les établissements scolaires (par exemple celui de 2001), s’adresse directement au personnel de l’éducation nationale. Comme du point de vue budgétaire ce décret n’apporte que des rares extensions horaires, ni de formation pour le corps enseignant, il devient « superficiel » du point de vue pédagogique et aussi par son application sur le terrain…à cause du « manque de personnel qualifié et de moyens » - alors que très souvent une école municipale de musique est à proximité et financée par la ville. Dans les meilleurs des cas cela aboutira à de l’animation « socio-culturelle » associée à l’école municipale de musique qui de son côté aura ses propres élèves et ses prérogatives pour remplir les classes de musique ou de répondre à la demande publique.
C’est dans ce sens que j’attache une importance capitale au mot mutualisation, puisqu’il est en ce qui me concerne, à la fois le garant de la liberté et la solution unique de lutter contre la singularisation des institutions républicaines de l’éducation et de l’enseignement dans le contexte économique. Il garantit également l’assurance d’avoir une progression pérenne des valeurs humaines à travers les générations et la société pluriculturelle d’aujourd’hui.
Le sens de la « mutualisation » tel que je l’entends et celui qui se retrouve en sémiologie chez Peirce. C’est à dire le mouvement intrinsèque de l’ensemble des éléments liés par leurs points communs et fondamentaux. Cela se retrouve aussi bien dans le cadre institutionnel que dans celui des programmes de l’éducation et de l’enseignement que nous aborderons plus loin.
Symboliquement j’imagine bien une « pyramide » à trois faces qui se construit en partant par la base et dont l’angle supérieur est solidaire de l’homogénéité de l’ensemble et ne prédétermine pas la position de chacune des pierres mais assume la cohérence de la représentation.
Mais dans un esprit plus pragmatique, puisque nous parlons de déficits budgétaires de l’Etat, cette mutualisation peut se faire tout simplement par le transfert de compétences entre l’Education Nationale et le corps professoral spécialisé dans les domaines artistiques qui sont déjà sur le terrain dans le cadre périscolaire.
Cet exemple n’est pas une révolution, mais au contraire ; il ne change pas la durée du rythme scolaire mais sa répartition et son contenu, ne modifie en rien la vie sociale et du travail et surtout ne coûterait rien de plus à l’Etat puisque les différents acteurs de la fonction publique territoriale sont déjà budgétisés en tant que charges financières pour les communes.
Mieux encore, cela simplifierait considérablement l’attribution budgétaire dans le domaine artistique et culturel tout en renforçant les liens historiques entre les matières pédagogiques.
Toutefois suivant cette transformation institutionnelle qui à mon sens devrait figurer dans « l’Agenda 21 », j’aimerais affirmer le principe éducatif français qui doit être en constante « rénovation » au point que cela devient une course tragique ayant la mission de régler tous les problèmes de la société pluri-culturelle.
Certes, lorsque plus de 50% des élèves et étudiants ne comprennent plus les mots et le sens cognitif des matières enseignées, la raison psychologique s’affirme par le faux questionnement au sujet de la « surcharge et de l’inutilité des matières enseignées » ! ! !.
Cela m’emmène brièvement (car le sujet est très long et complexe)à l’importance capitale des programmes étudiés et surtout à la formation pédagogique des enseignants du primaire et du secondaire.
Pour en venir directement à la proposition concrète, je dirais que la musique est histoire, est littérature, est architecture, est géographie, est mathématique et physique, est « chimie de la neuro-perception », est l'esthétique stylistique des langages sensibles dans une société où la pluriculturalité ne DOIT PAS être étudiée sous des formes comparatives entre les cultures, mais à travers les valeurs expressives communes et les « mots clés » à TOUTES les cultures. Disons qu’il existe une « sensibilité universelle » de l’intonation et du langage signifiant, ainsi que de l’expression qui « cultive » cette sensibilité individuelle.
Mais pour cela il faut que politiquement la volonté de la formation des générations d’enseignants soit revue dans cette direction, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Quelques mots en guise de réflexion
Pierre Bourdieu dans son livre Méditations pascaliennes reprend le sens technique du mot « skholé »: « temps libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences, et au monde. D'après Bourdieu, la « skholé » est « la plus déterminante » de toutes les conditions sociales des possibilités de la pensée « pure », et aussi la disposition scolastique qui incline à mettre en suspens les exigences de la situation, les contraintes de la nécessité économique et sociale, et les urgences qu'elle impose ou les fins qu'elle propose.
Selon Bernard Stiegler (in prendre soins de la jeunesse et des générations- Flammarion) une approche organologique de l’institution de programmes d’enseignement doit poser en préalable et en principe que :
-
dans une société politique et démocratique, le système éducatif est aussi ce qui instrumente les citoyens comme public qui sait (qui est savant en tant qu’il lit et écrit).
-
La citoyenneté est l’individuation psychique et collective conforme au processus d’individuation de référence fondé sur ce savoir partagé ;
-
L’individuation en général est ce qui articule le synchronique où se forme le « nous » avec le diachronique par lequel existe un « je », et cette articulation est une composition par laquelle se forme une réalité idiomatique….des langues des disciplines enseignées….qui sont des idiomes formels.
Aujourd’hui tous ces critères sont en « crises » puisque déphasés par rapports à l’homogénéité du sens des valeurs qu’ils représentent. L’Education comme l’Enseignement ne représentent plus le sens de l’enrichissement mais sont asservissement politique à la fluctuation des idéologies dominées par le pouvoir « gestionnaire » de l’économie.
Historiquement cela se traduit par l’alignement progressif de la pensée philosophique progressiste sociale au fatalisme monarchique et paroxystique du libéralisme.
Est-ce la question de l’aliénation d’un système de pensées d’élévation sociale de la République, qui a atteint l’apogée dans ses applications ? ou alors l’épisode d’une « crise » représentant le point de rupture entre deux « volumes » de l’Histoire qui finira par une implosion sociale ?
Ce « pouvoir dont le corps financier » entretient une crise permanente de « l’utile » et de « l’usage » immédiats, menant à « l’efficacité » signifiée et intégrée au « mouvement » centrifuge et spéculatif de la « normalité » libérale.
L’aboutissement à cette situation qui permet à la philosophie libérale de s’épanouir à travers la promotion des liens indispensables entre l’école et les priorités économiques du monde du travail, se fonde sur le « démantèlement » progressif des métiers manuels et de l’artisanat, ainsi que la dévalorisation volontaire post-urbanistique, des qualités et valeurs induite à l’être humain.
L’acquisition des connaissances ne serait plus tout simplement une valeur d’évolution et d’accession au statut de « savant » mais le moyen uniformisé d’intégration au travail grâce à la formation associée à l’utilité pragmatique et orientée dans le monde économique de l’entreprise productive.
Certes il est plus aisé de maîtriser un système fonctionnel dont l’ensemble d’individus sont constamment en mouvement perpétuel, sorte d’itération existentielle formalisée par le quantitatif matérialiste, qu’un système composé d’individus dont l’activité est réflexive et progressiste au sens de satisfaire le « soi remarquable » ; donc économiquement difficilement « canalisable » et aléatoire puisque relevant de la créativité non quantifiable de l’Esprit.
En « épousant » la raison gestionnaire de l’économie, cette démarche nous propose l’acceptation de la faillite philosophique en matière de cohésion nationale et son alignement au libéralisme socio-monarchique à travers le morcellement et la délégation des problèmes sociétaux, tel que j’ai évoqué dans la première partie de l’exposé.
Entre 2003 et 2011, c’est avec une certaine hypocrisie que les termes de « modernité et de progrès » de l’éducation et des programmes de l’enseignement, sont adaptés et médiatisés afin de maquiller la fatalité et l’impuissance de la politique républicaine et démocratique, qui joue une de ses dernières « carte » et dans ce contexte, est obligée de prendre une décision pour éviter le cheminement vers une « renaissance » médiévale.
Par ailleurs et à l’opposé du catastrophisme et fatalisme imposés par le paradoxe libéral, l’explosion de la violence primaire due à plusieurs facteurs dont celui du sentiment d’inutilité existentielle à cause de frustrations ressenties par impuissance d’arriver au « remarquable » de l’individu, se traduit souvent par le « hors système » ; cela montre que malgré un investissement faramineux dans les secteurs scolaires et artistiques, de la création évènementielle, dans « l’arrosage » constant des associations locales, il y a faillite des données éducatives et une confusion qui règne entre la culture de la « cellule » familiale et surtout l’enseignement des valeurs humanistes occidentales.
Dans ce sens, une autre réflexion devrait être portée au sujet de l’éducatif et de l’entendement, car le danger réside dans le regroupement en communautés qui défendent des valeurs culturelles historiques par manque d’une évolution pédagogique de la pensée moderne.
De l’inclusion communautaire à l’extrême fascisante hypocritement démocratisée, la confrontation (pour ne pas dire le face à face) avec l’évolution du socialisme, qui guide depuis toujours ma pensée, se retrouve dans un combat de forces inégales, puisque l’argumentaire extrémiste s’approprie le pragmatisme des paramètres économique de la condition critique des sociétés. ……………
RESUME : Proposition d’organisation à titre indicatif concernant une ville moyenne ayant déjà un conservatoire ou école municipale de musique (CRC ou non)
-
Recentrage dans un « corps commun » des enseignements artistiques, après analyse des moyens existants et figurant dans les états généraux de la Ville – dans le domaine de l’enseignement artistique et dont l’utilisation ne correspond pas aux institutions nationales, entraînant ainsi la diversification des dépenses. Cela implique de définir le CMM comme unedirection principale de l’enseignement artistiqueet non plus seulement comme un bâtiment unique de l’enseignement musical.
-
Etablir et impulser le réaménagement des temps scolaires avec les écoles du 1er degré selon plusieurs propositions constituées par le « dispositif artistique dominant ». Mission confiée à la direction du CMM avec une commission où figureraient les représentants du 1er degré et du 2d degré scolaires de la Ville et dont la vocation serait à la fois d’ouvrir et de mener les concertations de qualification de l’inspection, des équipes et des établissements des écoles primaires. Dans un premier temps cela permettrait d’évaluer les moyens nécessaires, les aspects budgétaires et d’établir un cahier de charge mentionnant les « dominantes » artistiques selon les établissements scolaires.
-
Aménagement des horaires scolaires (en résumé)
La présente proposition repose entièrement sur ce troisième point.
Il s’agit d’organiser la journée de l’enseignement général comme suit :
-
Ecoles primaires (niv. CP, CE1, CE2 ) : enseignement général inchangé le matin
Cursus artistique selon la dominante choisie par l’établissement scolaire 14h30 à 16h30
Niveaux CM1, CM2 : cursus artistique 8h30 à 11h30 ; enseignement générale assuré jusqu’à 16h30.
La démarche de cette inversion pour les classes de CM1 et CM2 permettra au corps enseignant de l’éducation nationale d’alterner les horaires afin de suivre et de contribuer à l’élaboration des programmes du « tronc commun » entre l’enseignement général et celui artistique dans les matières fondamentales : histoire, notations et écritures, français, géographie, mathématiques.
Exemples de Problématiques :
Le transfert de compétences concertées entre les inspections de l’Education nationale – plus précisément en commençant avec les écoles maternelles et primaires. Cela implique non seulement des conventions sur des actions annuelles ou tri-annuelles, mais l’établissement d’une convention unique impliquant l’ensemble des éléments reliant directement l’enseignement artistique (musique, arts plastiques, arts visuels, arts numériques et artisanat culturel) avec ses établissements scolaires.
A ce titre ce premier point repose sur l’impulsion dynamique des communes territoriales ayant déjà un établissement municipal d’enseignement artistique (ce qui limite l’investissement local) à travers lequel il est développé une cohérence avec le tissu associatif spécialisé dans le domaine des arts.
2. Mutualiser l’existant et les moyens humains et techniques des programmes sur l’ensemble des établissements.
Impulser la dynamique nécessaire à l’aboutissement de la convention d’enseignement entre les matières artistiques et celles scolaires (Circulaire EDUC NAT. mai 2013, Rapport CESE août 2013) . Elle doit être impulsée par les Villes, en se basant sur les responsables des structures et coordonnée par un directeur ayant le statut de l’enseignement artistique spécialisé.