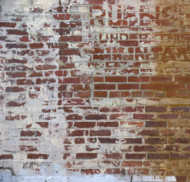Franco Donatoni - Chap. 1 - Ultima Sera Dialogue entre l'Artiste et l'Artisan
Andante…
Composer avec les sons, écrire de la musique, entendre et voir les choses qui défilent en miroir et avoir instamment le réflexe de traduire cela en divers graphismes, gestes, mimiques, interpréter l’Etre se nourrissant de votre imaginaire et le "référencer" selon vos expériences, être par la force des choses, spectateur et acteur de mouvements inattendus, être dans la vraisemblance et toujours revenir à la vérité crûment déterminée par l’étrange, réfléchir à l’inutile, aimer par le sacrifice de soi, affirmer sa détermination en prenant le risque de l’erreur et en transformant celle-ci en phénomène constructif grâce à l’expression de l’esprit, mais surtout avoir véritablement la force et le courage d’affirmer l’œuvre architecturée par l’imaginaire d’un ressenti en tant que vérité et fondement d’une histoire singulière, la "chose" engendrée par les mouvements de l’Ame, la votre mise en évidence par une volonté apparaissant étrange aux autres ? Accepter de vous livrer, de livrer l’œuvre au point qu’elle ne vous appartienne que par la mémoire des choses, la faire connaître, à un moment que vous décidez, aux regards des autres à travers leurs ressentis, entrer sans y être dans l’intimité affective de chacun, sans connaître les raisons de leurs émois, accepter d’être rejeter, refuser, aimer, haïr l’indifférence et en souffrir en soi par la passion, Poète incertain, avoir le doute de sa sincérité et regarder la Mort avec les yeux du bouffon en divertissant le public, le même que celui qui regardant Mercutio applaudissait sa souffrance, avoir la satisfaction de voir des sourires, de comprendre les écritures des larmes et des joies, noter, se souvenir, s’interroger et se répondre sans regretter, voir l’Homme ou la Femme dans sa nudité picturale, fiction de ses propres rêves, Rêves et cauchemars éveillés de Nadja, vivre la crise comme un espoir, combattre tous les dogmes et les systèmes figés en justifiant toujours la valeur des qualités humaines, construire avec les éléments qui vous composent, qui vivent en vous, livrer votre mémoire, vous décomposer pour vous recomposer à chaque instant, discourir et puis se taire, utiliser le contenu de vos propres silences, vivre les silences par l’assourdissant, aspirant à se taire en vociférant ou en récitant en boucle vos propres boucles, une bande à Godot, être humble, humble par le regard qui déconstruit pour ressentir le "beau" de l’expression et la "laideur" de l’indifférence, Etre l’Ecriture et prendre conscience de soi par la vraisemblance de la notation ….
Voilà un début de ce que vous seriez si vous aviez le "toupet" de dire je suis compositeur. Vous passeriez votre vie à l’intérieur d’un miroir bouillonnant où s’affairent ceux qui garderont peut-être un souvenir de la poétique avec laquelle vous avez ordonné ce testament immortel, aïeul d’un Montcorbier et " Grâce " de l’histoire d’aujourd’hui; crise et critique des civilisations en mutation, des expressions vivantes ailleurs, en dedans ; vous diriez qu’elles ne sont pas plus laides ou plus belles que celles du passé, vous laisseriez à d’autres le magister de l’acclamation savante des paroles mortes par le désespoir de leur cause, résonance de "l’art est mort", de la "mort de la modernité", du classique " post-modernisme ", et vous parleriez plutôt des entrailles qui composent progressivement, année par année, la recherche du "non-dit selon mes sens", du " comment le dire autrement tout en restant moi"; racines Antiques ?, avant romantiques ?, puis des impressionnistes aux surréalistes, modernes ? et jusqu’à "respirer" des valeurs humaines souvent bafouées et diluées pour êtres vendues, commercialisées, perdues ; vous prêcheriez la richesse et parfois la cruauté des cultures, vous parleriez de l’Etre créatif, du savoir et de la soif de connaître au-delà de l’idéologie médiatisée, du facile à faire, de l’Art ludique des grandes surfaces commerciales, et là, même vos silences seraient " sonores ", gênants, dérangeants.
Vous vous insurgeriez à chaque fois devant les clercs remplacés par les fourberies de "jongleurs d’images" et de palimpsestes maniérés; ceux qui entourent et construisent les remparts d’aujourd’hui en transformant en bal masqué l’Histoire des humanistes; ceux qui détruisent l’idéalisme en grignotant sur les sens et en imposant l’histoire "ensanglantée" comme fatalité du vivant héroïque….
Ainsi, en marchant vers cette " salle " pour vous redécouvrir et vous livrer mais pas vous rendre, comme le fit maintes fois Franco Donatoni, je vous suggère de percer le miroir en imaginant la vie de ce "raggionere" de l’Existence, acteur de son histoire et issu d’une "famille" qu’il ne choisit pas, mais où le Hasard dans sa hâte, le poussa sur la scène en traçant ses pas sonores, gravant ses interrogations avec l’humour du Destin espiègle, celui qui aime jouer avec chacun de nous.
Pour mieux cerner l'œuvre de l’homme Franco Donatoni, j'ai essayé tout au long de ce parcours entre l’existence et sa chronologie, la "psychanalyse" de l’écriture d’un artisan et ses limites, de rendre les faits à travers ses propres références et en évitant le plus possible les écarts ou critiques envers sa personnalité.
La manière de procéder à sa biographie et à l’analyse, fait état du personnage tel qu’il était, mais j’ai ajouté sous forme d’essai d’esthétique, l’analyse de certains phénomènes qui gravitaient auparavant, pendant et après Donatoni. Inévitablement, tous les compositeurs font partie d’une société qu’ils observent et leur expression est en rapport direct ou indirect avec les faits, en commençant par la vision qu’ils ont de leur propre expérience vécue ou imaginée.
J’ajouterais que la critique de celui qui dévoile la pensée d’un autre est tellement différente de celle de celui qui écoute et qui ressent, que la meilleure manière de décrire Donatoni et son œuvre, est de le présenter dans son intégralité. Par conséquent, ce qui m'a paru important dans le domaine de la composition, c'est d'amplifier le chapitre analyse, puisqu’il souligne la continuité et l'intégrité de son œuvre tout en confirmant le fait qu'il y ait une certaine dissociation entre la création musicale et l'implication des événements extérieurs.
Lumières et Obscurités d’un personnage résolument moderne,
souvenir et testament palimpseste de la mémoire
Ouvroir d’une mémoire imagée
J'ai rencontré Franco Donatoni pour la première fois en 1986, lors de ma brève participation en tant que compositeur au Séminaire International de Villeneuve-lez-Avignon.
A l'époque, étant dans la tourmente des novices face au "Monolithe" donatonien, nous sommes restés sur des positions divergentes quant aux concepts compositionnels. Entre autres, je restais inflexible devant son refus de croire qu'il peut exister un illogisme volontaire, instinctif et schématisé aussi bien intrinsèque au processus de l'écriture, que dans le développement d’éléments appartenant au matériau fondamental et qui échappent à un système donné; autrement dit la notation du sonore devient un style à soi lorsqu’il s’agit de l’ordonner par la forme selon un certain illogisme fourni par le hasard du ressenti. En ce qui me concernait et dont je reste persuadé même aujourd’hui, c’est que le matériau organisé a priori se transforme sans cesse a posteriori selon une démarche systémique. Cela implique parfois "l'erreur" induite à la scolastique et qui s’avère subjectivement constructive et objectivement stylistiques par l’affirmation constante de ses propres citations – vérité singulière qui nous mène au-delà d’un système conventionnel.
En définitive, deux ans après avoir terminé Ronda pour quatuor avec piano, Franco manifestait avec virulence son indéterminisme, en défendant l'automatisme rigoureux et le sens de la codification, gestuellement et musicalement interprétés. Cette démarche devait aller jusqu'à l'épuisement d'un mono matériau sonore-source (plus classiquement dit, thématique musicale), ce que sous-entend du point de vue technique, la transformation et la mutation signifiant la pensée de l'écriture musicale. Il fonda ainsi toute sa pédagogie sur la manière d’organiser le matériau afin de lui donner un sens stylistique: le sien.
Malgré sa position intransigeante, un des aspects de son enseignement me confortait dans l'idée que son écriture était en rapport avec l’évolution poétique du sonore, puisqu'elle émergeait (d’après lui) de l'univers préexistant d'un langage structuré, qu'il soit d'origine gestuelle ou littéraire. Dans toutes ses œuvres, le matériau représente un ordre de hauteurs sonores, un condensé du subjectif gestuel codifié; c'est à dire transcrire un événement sensible à soi qui se détermine d’après des éléments qui s’ordonnent de manière intercalaires par "intelligence", selon le choix des différents types de structures harmoniques qu’il détermine. La complexité de ces structures réside dans leur organisation stratifiée et timbrale – caractéristique physique de la perception du sonore instrumental - et se transmet lors du rapport entre l’audition et l’entendement.
En lien avec cette démarche, tel Vasarely et selon Donatoni, le phénomène de la création musicale représentait le savoir-faire de l'artisan, mais à la différence du peintre-plasticien, Franco faisait usage essentiellement de la codification musicale traditionnelle. Sa position tenait naïvement du propos de Lévi-Strauss quant à la notion d’artisan de l’Art. Ma position également, puisque je parlais "d’erreur constructive", également avec une certaine naïveté, puisque Franco Donatoni avait une philosophe particulière et de son point de vue anthropologique, il avait adopté un mode de conscience existentielle ; mode qui orientait son esprit vers un aspect pseudo cognitif de la poétique représentée par la convergence des disciplines.
Son "discours" et ses écrits, étaient des mélanges "savants" entre psychanalyse, croyances, esthétique et existentialisme. Par ailleurs, cette poétique était refoulée au second plan, invisible comme un palimpseste de la notation des sons et qui catalyse et détermine la cognition ordonnée par la géométrie induite au système de notation. J’aimerais justement souligner l’aspect intrinsèque entre mathématique et géométrie, car les deux représentent le fonctionnement et l’abstraction de ce qui est visible et qui se prête à la poétisation, à l’invisible intérieur. Les deux sciences sont fondatrices de la dialectique de "l’ordre" et du "désordre" des systèmes; entre autres, elles engendre des mutations, et des transformations du mouvement volumétrique du rapport Espace-Temps. Toutefois, l’aspect scientifique de Franco se réduisait à la vision poïétique et naviguait ainsi entre ses aspirations "oulipiennes" et la recherche du sens musical ordonné. Le conflit intérieur permanent qu’il vivait provenait de cette distance qu’il mettait toujours entre le sens qu’il donnait à ses œuvres et le déroulement de sa vie. Cela le menait souvent à des dépressions suscitant des interrogations au sujet des limites et des causes. Mais revenons à ma rencontre avec le maestro.
Le hasard fit que sept ans plus tard, en 1992, c'est à dire une génération selon le découpage de la vie imaginée par Franco et suivant la suggestion du compositeur Hugues Dufourt qui dirigeait à l’époque une unité CNRS à l’IRCAM-EHESS,
je soumettais la problématique de l'écriture de toute l’œuvre du compositeur italien. A mon sens, l’intérêt d’une telle analyse résidait dans le fait de montrer comment l’Artisan était une figuration dialectique et transcendante de l’Artiste, entre les expérimentations et la réplication; sorte de mimesis de la notation, dont le hasard devient précurseur de l’écriture. Les analyses que je présente dans cet ouvrage tentent de répondre aux interrogations du "comment Donatoni procédait pour être l’artisan de sa créativité ?". Rappelons qu’en Italie à l’époque des années 1927, se côtoyaient l’effervescence des concepts, l’expérimentation du " beau " expressif, avec les variantes esthétiques d’un "verdisme éducatif", mais aussi que la philosophie était absorbée par l’idéologie et la propagande dictatoriale pendant une courte période de flottement ponctuée par la crise des années ’29 et qui mena à la seconde guerre mondiale.
En réalité, les transformations socio-politiques d’une période entre la première guerre mondiale et la seconde qui se préparait lorsque Donatoni n’avait que dix ans, relèvent de la dichotomie entre l’Humanisme philosophique qui se trouva à la base de la crise de conscience des ayant droit à l’existence et la barbarie des intérêts économiques de certains. Le phénomène qui prenait de l’ampleur, était en lien direct avec le devenir d’un "être humain géré" par tous les moyens de la communication et de la cohérence des nations grâce aux moyens souvent utilisés par les monarques et par la Sainte Institution Papale, telle l’orientation idéologique des Arts vers des représentations dominantes. La musique détournée de son appartenance à l’Etre humain créatif, philosophie et poétique, était un des ces moyens représentant la force, la "vérité du beau", la définition de l’être uniformisé par l’histoire héroïque. Cette confrontation présente dans l’évolution des civilisations, devait engendrer comme toujours, une période que je nommerai "de compression du Temps" pendant laquelle l’art et l’éducation culturelle deviennent des moyens politiques et non plus créatifs et libres. Les avant-gardes apparaissent ainsi comme les facteurs et protagonistes de la "rupture" avec l’Académie institutionnalisée politiquement. Les convergences et les "implosions" sociologiques mêlées aux mouvements politiques des années 1945, le nationalisme artificiel mais bien ancré par les pouvoirs en minorant les identités culturelles régionales tout en les utilisant, allaient à l’encontre de l’évolution du "rêve expressif" d’un imaginaire qui n’a jamais cessé d’être moderne. Mode, Moderne et Modernisme iront à la conquête des institutions gestionnaires de l’art et implicitement des aspirations artistiques des libertés d’expression.
Du point de vue musical, la problématique suscitée par Franco est un exemple de cette crise d’harmonisation entre modernes et ce qu’on appelle " l’avant-garde " car il était moins assujetti au progrès des technologies qu’à l’évolution de la notation musicale; ou plutôt, à l’impossibilité d’évoluer autrement qu’à travers la classification opérée par la "réalité" d’un seul et unique type de notation - qu’il mentionnait à chaque fois, comme résultant de la préexistence des choses.
Par conséquent, je "rentrais" dans le personnage et cet ouvrage biographique au sujet de Franco Donatoni – l’homme, l’œuvre, l’époque - prenait une dimension définitive lors de notre seconde rencontre à l'Académie Chigiana à Sienne en 1993 - 94, puis chez lui à Milano entre 1994-95 et pour finir à Strasbourg, à Paris, Nanterre et Royaumont entre 1996 et 1997.
Rendez-vous fixé à 15h lors d’un après-midi du mois d’août en 1993, j’attendais Franco devant la magnifique entrée de l’Academia Chigiana, en me demandant comment il allait réagir après tant d’années pendant lesquelles il m’avait certainement oublié. Au bout d’un bon quart d’heure je l’aperçus, imposant, les yeux couverts de grandes lunettes noires, une chemisette avec des manches courtes qu’il portait l’été comme l’hiver et le visage fatigué, orné par sa cicatrice auréolée à la tempe. En me voyant, il me regarda, comme s’il fouillait dans son sac à souvenirs, et soudain me fit un grand sourire en me donnant une tape sur l’épaule et en disant "E ! Alora ! Thomassin" !
Mes brèves introductions sur l’ouvrage, sur ma mission de thésard et ma joie de le revoir, devenant inutiles, il me demanda de le suivre à son cours et d’entrer dans son univers : la "salle de théâtre".
Après tant d’années, j’étais très curieux de voir les élèves inscrits auprès du Maestro, puisque ses cours de composition faisaient grand bruit dans notre petit monde musical en France. J’apprenais plus tard que la table de la salle des cours avait changé depuis qu’il avait planté un couteau dans le vestige du XVIIème siècle sur lequel reposait les partitions de ses disciples.
Il s’assit pour "patronner" les 7 mètres d’une table à rallonges, où reposaient des partitions et autour desquels les stagiaires s’empressaient d’ouvrir leurs compositions tout en bavardant bruyamment, et m’invita à coté de lui pour qu’on puisse parler. En fait tout le monde parlait par petits groupes, pendant qu’un stagiaire avançait timidement mais fièrement sa partition. Franco regardait au début le travail du stagiaire affairé, puis après une minute de silence, le stagiaire racontait son histoire avec beaucoup d’émotion, avec des mots "techniques" du genre ici j’ai placé un matériau qui se renverse, ici et là les intervalles permutent d’un ambitus à un autre et puis là…. etc.. Franco l’écoutait en tournant les pages, puis il levait son regard paternaliste en pointant un groupe de notes sur la partition et en disant " ma perché ? " et à la fin d’une explication gênée ou très volontaire de la part du stagiaire, le verdict tombait en même temps que la sentence " va bene, va bene, lavorare, lavorare ! ! " …au suivant !
Je me rappelle qu’à un moment donné se présenta un jeune stagiaire de Malte. Après des commentaires sur l’accent maltais, Franco me fit une "belle surprise"; il me désigna à l’élève en disant : "Arthuro va te dire ce qu’il pense de ton œuvre". Au début j’ai espéré qu’il s’agissait d’une blague mais, en regardant la pseudo fugue et un contrepoint maladroitement contemporain avec quelques dissonances, j’ai vite réalisé que j’étais le porte-parole de la pensée inavouable du Maestro. Alors, j’ai commencé à lire la partition et chercher dans ma tête des formules polies et d’une esthétique convenable afin de faire comprendre au stagiaire que la modernité ne se résume pas aux dissonances. J’avais beau chercher le sens, l’origine, le gestuel selon l’enseignement de Franco, je tombais sur le même ingrédient et les obligations d’écriture sans l’ombre d’un début de "souffle". Comme je tardais car en regardant du coin de l’œil la mimique de Franco et les sourires "savants" des stagiaires, les mots me venaient en même temps qu’un rire maladroitement masqué par le refus de paraître un prétentieux. Et mon retard profitait au stagiaire qui me donnait des explications sur l’enchaînement des croches et des noires, de l’esprit médiéval, de la résurgence…. Avec un sourire retenu Franco remarqua ma lenteur. Pour finir, je l’imitais, me servant de la langue française comme paravent du savoir et en affirmant: "c’est intéressant, mais peut-être que le regard conceptuel du formel classique ne suffit pas, non ?". Un grand silence servait de réceptacle à mes paroles, et le stagiaire me lança un regard poliment offusqué alors qu’honnêtement je ne pouvais lui dire autre chose que de remplacer la "résurgence" par l’insurgence, de noter moins et de rêver plus. Cela dit, cette année-là, la salle entière, sauf deux ou trois jeunes compositeurs dont mon ami espano-argentin Daniel Sprintz et une compositrice canadienne, était composée de "petits" Donatoni, qui avaient plus hérité du principe d’invention imitative que de l’écriture. Mais bon, c’était mon humble avis confirmé par Franco plus tard lors de nos discussions, et qui se trouvait certainement intrigué mais aussi très flatté par la marque de son style indélébile chez ceux dont l’idée de la création musicale s’arrête à un exercice d’automatismes qui s’enchaînent logiquement.
A une certaine époque, comme depuis toujours lorsqu’il s’agit de perpétuer un système donné, l’apprentissage était la surenchère de l’imitation par laquelle les Maîtres évaluaient si le jeune compositeur pouvait dépasser la part conservatoire pour trouver son chemin.
En tous cas, même en 1993, il était de plus en plus rare de reconnaître un jeune compositeur "donatonien" par son style – à moins d’avoir une mémoire visuelle et auditive excellente pour reconnaître sa voix.
Cela dit et afin de ne pas me faire mal interprété à travers mes écrits, j’aimerais apporter toute ma reconnaissance pour des anciens stagiaires de Franco Donatoni, et qui sont aujourd’hui des références musicales reconnues et plus ou moins médiatisées, tels (et entre autres) les compositeurs Yvan Fedele, Edith Canat de Chizy, Daniel Sprintz, Christophe Looten, J-M. Dalbavie, etc….Il faut ajouter que pendant plus de 20 ans, plusieurs centaines de stagiaires compositeurs se sont succédés à ces stages entre Villeneuve-les-Avignon et l’Academia Chigiana à Siena.
Au fur et à mesure de nos entretiens lors de ses cours de composition et en présence de ses élèves, j'ai compris qu'il était impossible de parler de Franco Donatoni et de son œuvre, sans se confondre avec l’imaginaire d’un metteur en scène à la fois concepteur et acteur. Pour illustrer cela, je vous propose de mémoire, une autre anecdote au sujet de l’attitude théâtrale de Franco, et qui m’a été racontée comme s’il s’agissait d’une scène d’un film de Fellini.
Lors d’un cours de composition qui habituellement se passait le vendredi à l’Accademia Chigiana de Siena, Donatoni annonçait aux stagiaires qu’il devait partir trois jours à Madrid. Pour leur rendre service et afin de regarder leurs travaux, il promettait de venir le samedi matin très tôt avant de prendre l’avion. Le lendemain à 8h du matin, chargé de croissants, Franco arrivait dans une classe vide, les élèves n’ayant pas eu la sagesse de venir voir le maître avant son départ. Trois jours plus tard, de retour d’Espagne, Donatoni avait acheté un fouet à Toledo. A son arrivée pour le cours du matin, il demandait à tous les stagiaires de se mettre en rang et de passer un à un devant lui (assis dans un fauteuil). Il leur donna un papier sur lequel les fautifs devaient lire quelque chose du style: Franco, notre père pardonne-nous d’avoir été absent….. etc. A la fin de chaque lecture, le Maestro claquait son fouet sur le parquet en disant à haute voix : Perdonate ! (je te pardonne).
Malgré le sens " expressif " indéniable, la démarche est tout de même déplacée, étrange pour des stagiaires adultes, mais avec recul, elle constitue une très belle leçon de composition à travers une théâtralité pirandelienne. Nous pouvons voir cela comme une cruelle vengeance, mais aussi (peut-être moins si nous faisions partie du groupe puni) comme la représentation narrée d’un enchaînement d’images photographiques de l’imaginaire du lecteur spectateur que nous sommes.
Donatoni utilisait instinctivement la narration pour décrire ce qui l'entourait et les événements auxquels il avait été confronté. Il considérait qu’évoquer ses rêves représentait l'aspect imaginaire et théorique de son langage et que l'écriture musicale le matérialisait parfaitement; souvent son "discours" s'orientait vers des histoires vivantes structurées, dont l’écriture de l’œuvre apparaissait à travers un calque.
En 1993, trois années avant la composition de son opéra Alfred, Alfred.., il me fit une description complète de l’œuvre. L’histoire qu’il me raconta, avait eu lieu à Melbourne, puisqu’il fut foudroyé par une crise grave de diabète l’obligeant à l’hospitalisation aux urgences. Il accompagna son histoire de larges intonations de ce qu’il voulait écrire. Tous les personnages de l’hôpital étaient plus vrais que nature, par leurs comportements, leurs goûts pour la musique et leurs mouvements répétitifs et réguliers. Las de la nourriture de l’hôpital, il s’évadait pour rejoindre un ami gastronome mais l’alerte donnée par son épouse mit fin à son évasion. Ce passage ne figurera pas dans son opéra, qui à l’origine devait avoir une durée de 33 minutes. A l’époque, à ma question du pourquoi un opéra de 33 minutes, il me répondit qu’il n’avait pas à dire plus que l’histoire elle-même et que ce nombre était diabolique, symbolisant sa destinée. Mais lorsqu’il composa l’œuvre, il finit par se rendre "raisonnable" face aux producteurs, en ajoutant une introduction et en allongeant d’une heure sa durée tout en éliminant le coté drôle de son escapade. L’œuvre donnée en première création à Nanterre en 1996, avec Donatoni dans le rôle du malade, rentrait dans la "norme" des drames fantasmagoriques contemporains. Parfois, tel Mercutio, le public interprète mal l’humour à l’intérieur d’un genre dit "sérieux" et surtout quand le sentiment moralisateur de la tragédie est absent. Franco fit le malade sur scène tous les jours pendant un mois, alors qu’il était déjà réellement malade et même gravement. Jour après jour, dans la salle du Théâtre des Amandiers de Nanterre, se succédait un public devant lequel le malade n’avait qu’un sens théâtral, car il n’avait aucune autre réalité que celle de l’image picturale. Il était le sujet d’un tableau et le point de départ de toutes les figures en mouvement: le géniteur qui se décompose en composant l’œuvre. Mais ce qui est de l’homme Donatoni, le malade autour duquel s’agitaient et se mélangeaient ceux qui ont une fonction – hospitalière – et ceux qui font partie de sa vie, est souvent le fruit de l’épopée que nous découvrons à la lecture de ses deux ouvrages fondamentaux, thèse et antithèse de sa théorie compositive, Questo et Antecedente X.
Les deux ouvrages écrits à dix ans d’intervalle et dont nous reparlerons plus loin, utilisent une terminologie hétéroclite abordant entre autres la sémiologie et la philosophie, ainsi qu'une attitude psychanalytique face à un type de mécanismes qui fonctionnent dans une dimension parallèle.
Ces mécanismes mettent en scène le "jeu" permanent entre la mémoire et la volonté d’exister comme de l’esprit qui s’affirme en permanence par sa singularité.
La source de l'idéation sonore que Donatoni acquiert progressivement par sa volonté - c'est à dire dans le domaine musical chez Bartok, Schoenberg et Webern et dans le domaine philosophique, psychanalytique et littéraire, chez Kafka, Freud, Weil et Musil – est en opposition avec les œuvres et les représentations musicales de son enfance. Après ces études, c'est le hasard de sa rencontre avec J. Cage qui suscita sa curiosité pour d’autres disciplines de l’esprit telles l'hindouisme, le taoïsme et même la sagesse confucéenne occidentalisée. A l’égard des musiques extra occidentales, sans que cela soit péjoratif de ma part, précisons que la méconnaissance du langage spécifique à la dite culture et de l’expérience du vécu, entraîne souvent un phénomène d’appropriation par des emprunts techniques et subjectivement exprimés. Expliquons cela par le transfert sensitif de langages appartenant à sa propre culture envers l’assimilation d’une identité sensible qui reste liée à l’imaginaire de ses propres origines. La fait de vivre et de se mouvoir à l’intérieur de ces pensées donne lieu à des réalisations inspirées mais également au vraisemblable des figures expressives de langages sensibles qu’on "fabrique" de manière conceptuelle.
Pendant une longue période de sa vie, Donatoni se "confectionne" ainsi sa théorie à partir de la notation traditionnelle et se forge un caractère qui n’admet que ce qui est issu d’un monolithe harmonique. Il réfute tout ce qu’imposent les contraintes d’évolution de l’écriture le menant vers une démarche qui le forcerait de traiter l’aléatoire. Rappelons qu’un des traits important qui forme progressivement sa personnalité, se trouve dans sa décision de traduire par les sons de façon directionnelle le gestuel, les postures et les mouvements – symétriques et asymétriques. Il extrait toujours l'essentiel, pour édifier en pictographies successives suggérant l’objet à travers l'organisation de structures musicales en apparence purement sonores et hors narration. Pour cette raison, il se modélise lui-même en évitant tout rapport entre la "phrase mélodique" signifiante, suggestive ou "parlante". L'usage de la notation graphique traditionnelle des sons représente l’habillage de la technique par laquelle il détermine la communication, dont le pouvoir est d’engendrer les sensations et signifier l’expression à partir de compressions harmoniques successives.
A l’exception de sa première période de formation, c’est une trajectoire quasi invariable dans sa conception de l’écriture, et cela malgré les modes et les différents courants qui bouleversent les arts pendant les trente premières années de sa vie. Franco envisage plutôt le renouveau que la nouveauté et cela en regardant toujours à travers le prisme de sa propre existence.
Dans ce sens il fait partie des modernes du XXème siècle, puisqu’il propose une alternative au beau postmoderne, celle de l’efficacité du ressenti par les mouvements du corps en absence d’un prétendu "absolu", sorte de clarté tonale attribuée à l’Esprit. N’appartenant à aucun courant de l’époque, ses différentes recherches compositrices ainsi que son concept de l'écriture se réalisent à travers l’automatisme qu’il se forge et qui prend très rapidement la dimension d’un style.
Le style qu’il acquiert par la technicité de la notation a le rôle du "garde-fou" et rentre en permanence en conflit avec toute intrusion d'ordre spéculatif. Il confirme ses dires par le refus de figurer l’émotion au premier degré; "Son" émotion émane de l’objet qui suscite souvent l'acte tragique dans l'œuvre.
Lorsqu'il affirme le procédé artisanal comme raison de la préexistence de l'œuvre et sa transformation de celui-ci à travers le phénomène de la perception de la part des auditeurs, la clarté n’est que la vraisemblance de ce qui est distinct.
Cela explique en partie sa fascination devant les nouvelles techniques de notation, mais aussi son éloignement en rapport avec les moyens technologique de transformation sonore, l'électroacoustique et l'informatique musicale entre les années ’60 et ’90. Paradoxalement, leur utilisation lui apparaissait "étrange", loin des gestes communicatifs. Pour lui, un tel usage constituait la modification physique de la notation telle la différence rencontrée entre la peinture et la photographie qui subira également une transformation par le numérique généralisé de nos jours. Tout ce qui lui paraissait échapper au contrôle du geste et du corps humain le fascinait mais aussi lui posait un problème d’entendement des langages synthétiques. Par exemple, en raison de sa conception baroque des timbres et de l'orchestration, l'additif des sons synthétiques et la complexité des recherches dans cette direction ne l'attireront que tardivement vers les années '90. Toutefois les structures resteront bien définies et ne se mélangeront pas. Le matériau générateur proviendra toujours d'une structure sonore traditionnelle.
Après lecture de ses ouvrages, en abordant plusieurs fois le sujet de la symbolique des nombres, ses réponses faisaient ressortir à des périodes différentes de sa vie, l'importance qu'il accordait à la mise en place dès le début de l’œuvre, d'une structure sonore qui matérialise et justifie le déroulement métrique et le sens du contenu. La notion d'ordre préétabli par les nombres existants, lui permettait d’affirmer la préexistence des caractéristiques affectives des symboles. Dans son livre La symbolique des nombres, Raoul Berteaux donnait une définition un peu scolaire mais adaptée à l’imaginaire de Franco: Les nombres naturels, qui se différencient des nombres imaginaires et des nombres incommensurables, peuvent être classés en deux catégories: celle des nombres concrets et celle des nombres abstraits; le nombre concret désigne une quantité ou un rang, tandis que le nombre abstrait évoque la seule idée de pluralité. C'est justement la conscience qu’il avait du croisement et du rapport entre l'organisation de l'ensemble formel de l’œuvre et de la pluralité de l’Etre qu’il imaginait être, qui le faisait douter dans sa démarche pour retrouver l’équilibre entre son existence et l’œuvre. En quelque sorte, il se définit par le rapport entre l’abstraction de soi et la représentation architecturée d’un "volume" constant le représentant en tant qu’objet d’une vie organisée en un ensemble de "panneaux" se déterminant par la trajectoire des figures dans la linéarité du Temps.
Paradoxalement et en comparaison avec d’autres compositeurs, les seules recherches mathématiques de Franco Donatoni se résumaient à ses études de comptabilité et surtout à sa volonté d'organiser l’aspect formel à travers la poïètique de l'œuvre. Lors de nos nombreuses discussions au sujet du chapitre Numeri figurant dans son ouvrage Antecedente X…, ses réponses étaient désarmantes; il niait toute connaissance de l’histoire des applications mathématiques en musique. Pourtant la construction de ses "panneaux" comme la présentation des nombres étaient liées au rapport nombre-sons ; pourtant son "histoire" correspondait au crible des nombres premiers inférieurs à cent, celui d'Eratosthène et aussi d’Euclide, puisqu’il partait du symbole pour aboutir à sa dénomination. Instinctivement pour lui, tout phénomène était quantifié a priori et identifiable a posteriori par un nombre dont la subjectivité résidait dans l’abstraction et la symbolisation de ses origines existentielles; sa propre "genèse". Ces rapports de la métrique et même de l’identification des sons constituant les panneaux n’avait aucune relation avec le traitement des langages, et il ignorait complètement l’Ecole de Vienne, l’existence d’un Frege, Russel et même Wittgenstein. En lui proposant plutôt l’idée d’un calcul symbolisé d’après Escher, il reconnaissait difficilement qu’il faisait ressortir involontairement une certaine géométrie induite au système sonore spécifique à l’architecture de ses œuvres. Franco parcourait le chemin inverse entre l’expression poétique et la construction des structures auxquels il attribuait la préexistence, signifiant forcément des sens que le compositeur ordonnait à sa guise comme le regard à l’intérieur d’un kaléidoscope.
Sans qu’il se réclame non plus de la mouvance "minimaliste", l'originalité de Franco Donatoni réside dans le combinatoire qu'il obtient à partir d'un matériau musical souvent très réduit, afin de produire une multitude de figures sonores jusqu'à l'épuisement total des possibilités.
L'architecture par stratification repose sur une trompeuse démarche contrapuntique, mais une véritable fluidification dans l'enchaînement des éléments sonores de base. Elle aboutit automatiquement à une structure des hauteurs qui définissent la fixité de l'ambitus (l’amplitude d’une voix, entre le son le plus grave et le plus aigu), suscitant cette sensation d’une "masse" en mouvement. Ce résultat est commun à d'autres compositeurs mais ce qui reste spécifique à Donatoni, c'est le fait d’aborder la verticalité harmonique comme une démarche de sinfonia, un ensemble d’objets sonores dont chacun possède son espace, sa période, son propre "panneau" à l’intérieur duquel il est en constante transformation. Dans la majorité de ses œuvres, cela s’architecture par la superposition de mouvements linéaires perpétuels. Toute verticalisation rencontrée représente un point d'un graphique imaginaire (à l'audition), endroit de passage obligé, lieu de rencontre des différentes courbes rythmiques et sonores. Rappelons que cette démarche le rapproche, sans qu’il y adhère, du mouvement des spectraux et des minimalistes, car son propos réside dans l'amplificationmatérielle d'un matériau rudimentaire et l'amplification du minimal (essentiel) dans un espace ou en rapport avec un support quantifié. Mais ne revendiquant aucun des flambeaux avant-gardistes, Donatoni se place toujours dans une position singulière. Il ne peut pas faire partie des post-modernes, malgré son surnom de "Donatok" en référence à l’admiration technique qu’il a pour la musique de Bartok, puisqu’il fait toujours preuve d'un esprit de recherche conceptuelle de l'écriture tout en modifiant les rapports sonores, malgré sa "fidélité" aux supports et à la notation traditionnelle. Dans ce sens, il ne cite que lui-même prenant le pari d'une pensée universelle et transmissible qu'à travers sa musique, celle dont il est
"l’artiste" de l'artisan.